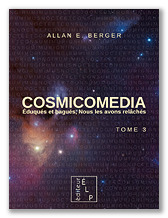Quatrième volet des voyages en Grèce méridionale. Nous voici au fin fond de l’est crétois. Des palmiers, du désert, des roches ravagées ; ce n’est pas encore l’Afrique mais ce n’est plus la Grèce. Au bord d’une plage qui regarde Chypre et le Liban, voici une ville déserte, dont il ne reste, comme toujours, que les premiers rangs de pierres. Voilà du reste pourquoi, de toutes les ruines de l’antiquité, ce sont les théâtres qui ont l’air le plus en forme : leur architecture rampe au ras du sol, il n’y a rien à faire tomber puisque tous les gradins sont déjà par terre. Mais les entrepôts, mais les agoras, les portiques, les basiliques : toutes ces constructions gisent éparpillées comme des cadavres d’animaux cent fois fouillés, rongés, suçotés et dispersés dans les broussailles.

Un staurogramme dans la basilique d’Itanos
La Crète orientale est un monde tellement à part. Tellement austère ! Lorsque, empruntant la route qui vient du Golfe de Mirabello, on aborde la longue descente sur Sitia, le paysage qui se déploie soudain semble écrasé sous une malédiction. Si, vers les plateaux qui entourent la ville et son aéroport, la végétation reste encore méditerranéenne avec du maquis et de la garrigue, on voit, vers l’horizon, s’étendre comme une zone morte, qu’un très ancien cataclysme aurait ravagée. C’est, sur le territoire de Palaikastro, une longue péninsule de montagnes roussies, crevassées, creusées d’orbites et sillonnées de profondes ravines où se réfugie une végétation déjà africaine ; une ondulation de bosses tabassées, fracturées, dont les grès épuisés lâchent au vent leurs sables, et où les calcaires, concassés par la chaleur et par les mouvements de la terre, s’éboulent en de longues coulées de séracs. C’est une contrée magnifique cependant, mais son premier abord laisse à songer que des dieux s’y sont battus, et qu’il n’y a plus d’espoir.
Sur la côte orientale de cette étonnante succession de presqu’îles, dont l’ultime soubresaut avant la mer profonde est le cap Sideros, cap de fer ou des étoiles, aux allures d’astéroïde abattu, les baies sablonneuses abritent des populations de palmiers dont la plus célèbre, celle de Vai à la plage mythique, voisine avec une grande bananeraie. Et juste au nord de Vai, l’érosion découvre les restes de ce que l’on nomme ici « la ville abandonnée » : Erimopolis. C’est-à-dire l’ancienne Itanos que mentionne, en passant, Hérodote en son livre IV. Il y écrit que les habitants de l’île de Théra, sommés par Apollon d’aller fonder une colonie en Lybie, ne trouvèrent quelqu’un connaissant la direction générale de ce mystérieux pays qu’en la ville d’Itanos, en Crète. Mais c’est qu’Itanos commerçait déjà, à cette époque, avec la Cyrénaïque, l’Égypte et la côte du Levant. Ce n’était pas rien que cette ville.
Car Itanos ne sort pas du néant comme une simple colonie. Dès la période comprise entre -1600 et -1450, on constate une occupation réellement dense du territoire, occupation qui alla jusqu’à commencer à modeler le paysage (voyez les informations qu’en donne l’École Française d’Athènes). Par la suite, la région fut délaissée, et ne récupéra véritablement de population qu’au début de l’époque Hellénistique, au troisième siècle avant J.C. Mais Itanos s’est agrégée entretemps, dès le huitième siècle, peut-être même dès le neuvième, sur fonds phéniciens si l’on en croit la légende, et fait figure d’exception chez les archéologues pour la continuité d’occupation funéraire de sa nécropole à une époque où, partout ailleurs, les humains s’étaient retirés. Itanos est née, elle a grandi, elle a attiré l’attention d’Hérodote, et son arrière-pays est devenu une campagne. La situation restera florissante pendant l’époque d’occupation romaine et jusqu’au septième siècle de notre ère. À partir de là, les gens s’en vont (pas de traces de céramique postérieure). Au Moyen-Âge, tout est désert, la campagne a disparu, et Itanos n’est plus qu’Erimopolis l’abandonnée.
Le site, en triangle, est borné au N.E. et au N.O. par deux petites acropoles (l’équivalent des oppidums d’Europe occidentale) juchées sur des collinettes, et par une bosse de plus grande importance au sud, partiellement ceinte d’un rempart, qu’on soupçonne avoir servi de casernement pour une garnison lagide, c’est-à-dire égyptienne des Ptolémées. Les maisons, l’agora sont, comme c’est l’usage, dans la plaine entre ces trois reliefs.
À l’abri du vent d’est derrière les pentes de l’acropole orientale, il y a une basilique. Ce n’est pas le seul édifice chrétien de la ville mais celui-ci est relativement bien conservé. Il est si vieux qu’il fait partie du monde dit « protobyzantin », ou encore « paléochrétien ».
Il est réglementairement doté de ses trois vaisseaux. La façade ouest, celle du parvis, possède donc trois portes, celle du centre étant la plus large. Il est amusant d’en observer les pierres de seuils : les traces des battants y sont inscrites, ainsi qu’un creusement de chaque pierre qui est l’effet d’une polissage soutenu, obtenu par le frottement de milliers de semelles au cours des siècles. Et là-dessus passent aujourd’hui le vent, les herbes sèches, quelques chèvres et trois touristes en route pour la plage.
C’est dans cette ruine cambroussarde que j’ai rencontré, sur un bloc de calcaire blanc veiné de gris, un symbole assez rare de la chrétienté antique : un staurogramme. La pierre, renversée la tête en bas, est un chapiteau de pilier à décor sculpté : le staurogramme y est entouré de deux rosaces simples.
Un staurogramme c’est une variante de chrisme. Et qu’est-ce qu’un chrisme, vous demandez-vous ? C’est un symbole comprenant les initiales de Jésus-Christ (I.X alias J.C) ou les deux premières lettres du Christ (X.P alias CH.R) agrémentées de l’alpha et de l’oméga de la citation célèbre. Le chrisme est un assemblage d’initiales.
Le staurogramme, lui, utilise les lettres Tau et Rhô mais pas en tant qu’initiales, en tant que dessins. Cette combinaison d’un Rhô croisé par la barre horizontale du Tau donne à voir la terrible figure d’un être crucifié – approximativement le caractère Ṫ.

Larry Hurtado, dans son ouvrage The Earliest Christian Artifacts: Manuscripts and Christian Origins, Eerdmans Publishing 2006, voit dans le staurogramme la première représentation supportable du christ crucifié. Le staurogramme serait une croix édulcorée. Il en donne la raison dans son blog, ainsi que dans un article dont voici un extrait : « It is a commonplace belief among historians of the early church that early Christianity did not emphasize Jesus’ crucifixion and that this did not change until the late fourth or fifth century. Crucifixion was shameful, and so (so the theory goes) Christians would have been hesitant to draw attention to the crucified Jesus. Indeed, some scholars have inferred from this the notion that pre-Constantinian Christianity avoided depictions of Jesus’ crucifixion » (“The Staurogram: Earliest Depiction of Jesus’ Crucifixion,” Biblical Archaeology Review, mars-avril 2013).
Ce symbole Ṫ n’est pas typiquement chrétien : on le trouve sur des pièces de monnaie antérieures même à la naissance de Jésus. On pouvait donc le placer ici ou là sans pour autant clamer sa christianitude, mais une fois orné de ses α et ω, il devient de la manière la plus revendicative qui soit un symbole tout à fait chrétien, qu’on peut rattacher désormais à la famille des chrismes. Et si vous ne voyez toujours pas ce qu’est un chrisme, allez regarder une icône dans une église orthodoxe.
En attendant, voici le staurogramme remis à l’endroit :

FIN